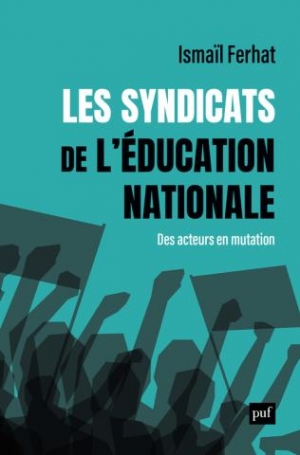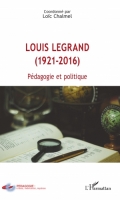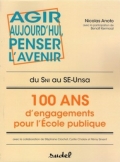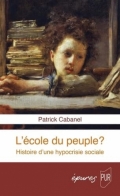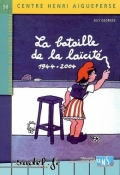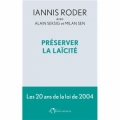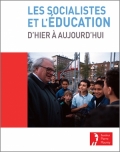Avis de Benjamin : "Le syndicalisme enseignant négocie entre le rationnel et les représentations illusoires"
Ce nouveau livre d'Ismaël Ferhat est le fruit du résultat d’une enquête menée durant l’année scolaire 2022-2023 auprès de 1 025 syndicalistes actifs appartenant à des syndicats de l’éducation. L’ensemble des syndicats de l’éducation est plus large que le groupes des syndicats enseignants. Ainsi à ce dernier groupe, on se doit de rajouter par exemple le SNICS-FSU (recrutant chez les infirmières), le Syndicat de l’inspection de l’Éducation nationale (SIEN-UNSA), le Syndicat national de direction des personnels de direction de l’’Éducation nationale (SNPDEN-UNSA) ou A&I-UNSA qui syndique les administratifs. Notons qu’une quarantaine d’adhérents à un syndicat de l’enseignement supérieur ont rempli le questionnaire.
Tous les syndicats de l'éducation nationale ont été contactés par Ismaël Ferhat, et on ne sera guère étonné d’apprendre que les plus coopératifs se sont avérés ceux de la FSU, de l’UNSA, et la CFDT Éducation (anciennement le SGEN-CFDT) et que par ailleurs l’absence de réponses soit venue du SNALC et de Force ouvrière. Les autres organisations syndicales ont été dans un position intermédiaire comme celles assez peu représentatives relevant de la CFTC, CGT, ainsi que CGC (récemment légèrement renforcée chez les PLP par Action et Démocratie) et de SUD. Suite à notre demande personnelle, l’auteur nous a confié que le pourcentage de réponses se répartissait ainsi la FSU représente la plus grande partie des réponses (45%), suivie de l'UNSA (22%), de la CFDT (15%), de SUD (8%), de la CGT (7%), de la CFTC (à peu près 1,5%) et de la CGC (environ 1,5%).
Le contenu de cet ouvrage sur les syndicats de l'éducation nationale, s'appuie également sur les archives de la FSU, de l’UNSA et de la CFDT Éducation plus de documents issus de publications syndicales diverses et d’entretiens notamment avec Luc Bentz (qui fut secrétaire national de l'UNSA Éducation), Jean-Marc Bœuf (secrétaire général de A&I), Hervé le Fiblec (du SNES-FSU) et Matthieu Leiritz (du SNES-FSU).
Voici le plan de l’ouvrage d'Ismaël Ferhat:
Introduction : Le syndicalisme de l'Education nationale, entre discours et mutations.
Chapitre 1 : Un secteur à la lumière des sciences humaines et sociales
Chapitre 2 : quelle représentativité et quels rapports de force ?
Chapitre 3 : quels militantismes pour quel(le)s militant(e)s?
Chapitre 4 : un secteur bousculé par la décentralisation ?
Chapitre 5 : la laïcité, sujet unificateur ou clivant ? Conclusion générale
Le système éducatif est toujours l'un des secteurs les plus syndiqués du salariat français. La Fédération de l’éducation nationale était largement dominante dans ce secteur jusqu’en 1992. Quoique les deux fédérations qui en descendent aient gardé un poids considérable, elles sont concurrencées par un myriade d’autres organisations dont la plus importante est Force ouvrière en progression significative aux dernières élections professionnelles (une des raisons de sa montée en puissance vient de la venue il y a quelques années chez elle d'enseignants de lycée professionnel issus du SNET-AA). Ceci alors qu’une fusion entre la FSU et la CGT est peut-être en voie de se réaliser. Il est notable que l’UNSA aux CAPN relevant de l’ Éducation nationale a toujours compté en son sein une quarantaine de pourcentages de voix issues de personnel non-enseignant, CGT et CFDT en ayant une trentaine et toutes les autres n’en comptent qu’une dizaine, voire un nombre tournant autour de 5% pour le SNALC ou la CGC.
La moyenne d’âge est de 45 ans dans l’ensemble des corps relevant de l’Éducation nationale pour l’année 2021 et l’ensemble des enseignants est globalement plus jeune que l’ensemble des non-enseignants. Les syndicalistes les plus actifs sont en moyenne plus âgés et depuis quelques années, nombre de retraités continuent à exercer les responsabilités. Si ceci n’est pas nouveau selon nous, d’expérience nombre de trésoriers étaient des retraités . Près de15% des répondants ont au moins un parent issu de l’immigration et environ 5% sont issus partiellement ou totalement de l’immigration extra-européenne.
Les organisations syndicales dans l’éducation nationale ont largement évolué depuis deux décennies par renouvellement de leurs adhérents en poste et par les réformes des organismes représentatifs imposées sous la présidence d’Emmanuel Macron (ces dernières entamant largement la conception du paritarisme). Comme l’écrit Ismaël Ferhat, ce secteur de défense de l’intérêt des personnels et de promotion de visées éducatives continuera à s’adapter en particulier du fait de la montée des personnels contractuels (dont d’ailleurs le nombre ne fut pas négligeable dans les années 1960 et 1970, à notre propre connaissance), la baisse des effectifs à scolariser et les transformations possibles de la fonction publique.
René Mouriaux, dans son ouvrage Le syndicalisme en France depuis 1945, écrivait qu’en matière de syndicalisme « s’affrontent quatre grandes conceptions, bridées par les contraintes de la conjonction politique, économique et sociale, un syndicalisme d’amélioration quotidienne, un syndicalisme de concertation, un syndicalisme de transformation et un syndicalisme de rupture ». D’après notre opinion personnelle, SUD relève de la dernière caractéristique, FSU, CGT et UNSA cumulent les trois premières caractéristiques alors que la CFDT Éducation et le SNALC se rattachent essentiellement aux deux dispositions d’abord citées et qu’enfin les autres organisations syndicales de l’enseignement (en raison notamment de leur faible représentation) sont à classer comme du syndicalisme d’accompagnement. Comme nous le disons souvent "on trouve tout à FO comme autrefois à la Samaritaine", aussi nous ne nous risquerons pas à caractériser autrement que d'opposition le syndicalisme porté par cette centrale, tant il nous semble hétérogène (d’ailleurs le SNET-AA, aujourd'hui à FO, avait rompu avec la FSU car il jugeait que celle-ci prenait globalement des positions trop socialement contestataires).
On retiendra ceci de l’ouvrage Les syndicats de l’éducation nationale: « Le militantisme syndical de l’Éducation nationale possède des caractéristiques affirmées. Celles-ci peuvent être déclinées en trois aspects cruciaux. Le premier est un vieillissement plus marqué que la moyenne de son champ de syndicalisation. Le deuxième est celui d’un niveau de diplomation très élevé. La troisième caractéristique est celle de la domination de trajectoires professionnelles stables et relativement rectilignes » (page 84).
Historiquement les militants syndicalistes de l’Éducation nationale étaient assez souvent militants d’un parti politique. On trouvait là assez des membres du Parti socialiste (d’ailleurs Ismaël Ferhat a livré en 2018 l’ouvrage Socialistes et enseignants. Le Parti socialiste et la Fédération de l’Éducation nationale de 1971 à 1992) et du Parti communiste mais aussi dans les premières années de la Ve République des adhérents au PSU. De façon plus marginale, les trotskystes de l’OCI (devenue le PCI, puis le POI) ont joué un rôle comme ceux de la Ligue communiste révolutionnaire (transformée en NPA). Parmi les répondants environ 18% ont été dans un parti politique.
L’adhésion à une structure associative en lien avec l’éducation populaire ou le mouvement dit "Freinet" est de l’ordre de 37%. Par ailleurs près de 14% ont été engagés dans une organisation lycéenne ou étudiante. Les non-enseignants ont été moins engagés dans une autre organisation que les enseignants, ce qui ne surprendra guère. Il est notable que ce sont les plus âgés qui globalement cumulent ou ont cumulé des engagements multiples concomitants. Il y a la possibilité d'adhérer à une association de professeurs d'une même disciplne, telles que l'APHG pour les historiens-géographes, l'APBG pour les sciences naturelles ou l'AGEEM pour les enseignants en maternelle; on aurait aimé savoir combien de ces responsables syndicaux font partie de ces associations. Dans ce dernier groupe, il aurait fallu mettre les enseignants se réclamant de Freinet (et non avec le groupe des associations d'éducation populaire) ainsi que ceux du CRAP (dont la revue est intitulée Les Cahiers pédagogiques) ou du Ceépi (pédagogie instituionnelle).
Un peu plus d’un quart ont changé d’affiliation à un syndicat au cours de leur carrière, toutefois il faudrait affiner entre ceux qui sont restés dans la même fédération syndicale (du fait d’un passage à une autre fonction, comme celle d’inspecteur de l’éducation nationale ou de direction d’un établissement) et ceux qui en ont changé pour des raisons d’orientation nouvelle de leur syndicat d’origine (on sait par exemple que des militants de la CFDT ont fui à divers époques vers SUD, la FSU ou l’UNSA).
Sur une échelle de 1 à 10 partant de la gauche et allant vers la droite, les militants de SUD crèvent le plafond à 1,45 et ceux de la CGT et de la FSU les suivent à une honnête distance. Les membres de la CFDT et de l’UNSA ont un positionnement très dispersé, signe d’un certain pluralisme de leur composition. Les membres de la CFTC et de la CGC ont une positionnement bien plus médian sur ce baromêtre, comme on s’en serait douté. La tentative de fusion entre le CGC et l’UNSA avait échoué et il est sûr que les modes de pensée des militants de l’éducation nationale de ces deux organisations se sont plus éloignés que rapprochés en quinze ans, d’après nous. Pour exercer leur responsabilité syndicale, seuls 2,5% des répondants ont une décharge totale de service, près de 53% ont une décharge partielle et les autres n’ont aucune décharge.
Les positions des centrales syndicales par rapport à la décentralisation sont très diversifiées et il est rappelé par des textes (faute de répondants) que Force ouvrière le SNALC furent et restent les plus hostiles sur ce point. Ceci dit FO a été amenée à demander que les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS), passés d’une gestion étatique à une gestion départementale à partir de 2006, bénéficient d’avantages supplémentaires propres à la fonction territoriale. Moins hostile aux perspectives de décentralisation, mais marquant des réticences on trouve l’ensemble des autres organisations, à l’exception de la CFDT qui est très nettement la plus favorablement ouverte à la décentralisation éducative.
Le dernier chapitre traite du rapport à la laïcité des syndicats de l’éducation nationale. Il est rappelé que la création du Comité national d’action laïque date de 1953, et que sur ces cinq composantes, deux sont syndicales à savoir le Syndicat national des instituteurs et la Fédération nationale des instituteurs. Toujours actif au XXIe siècle, il a vu logiquement le SE-UNSA prendre la place du SNI et l’UNSA celle de la FEN. Dans le passé le CNAL a dû composer avec de nombreuses lois favorisant l’enseignement privé dont évidemment en 1959 la loi Debré et au retrait en 1984 du projet Savary ainsi qu’à la tentative de François Bayrou (alors ministre de l’Éducation nationale) de proposer un financement accru des collectivités locales dans l’enseignement privé.
Toutefois à partir de 1989, se pose en plus la question de la manifestation de la foi musulmane (mais aussi un peu plus tard et marginalement sikh) dans les établissements scolaires publics. Le syndicat des chefs d’établissements au sein de l’UNSA (en l’occurrence le SNPDEN) est le fer de lance des idées portées par le texte du 15 janvier 2004 sur l’interdiction des signes montrant ostensiblement une appartenance religieuse, il est alors fortement appuyé par A&I-UNSA (majoritaire dans les personnels administratifs et d’intendance) et le SNALC. Il est notable que les autres organisations syndicales sont dans l’abstention et le refus de vote, aucune n’allant contre au Conseil supérieur de l’éducation. Les dirigeants du SNES ont fait parfois entre eux le grand écart sur la question ; d’ailleurs la FSU et le SGEN avaient signé une tribune hostile à la loi , rajouterons-nous personnellement. Il n’est pas précisé, dans l’ouvrage, que SUD Éducation n’est pas représentée alors dans l’instance en question, mais quelques pages plus loin il est précisé qu’elle a toujours été farouchement hostile à cette loi. Aussi absent de cette instance et n’ayant pas de militants ayant fourni une réponse au questionnaire, le SNET-AA est un ardent défenseur des mesures en question.
L’assassinat de Samuel Paty en 2020 amène FSU et UNSA Éducation à insister sur la nécessité de faire passer chez les élèves les valeurs de la laïcité en s’appuyant en particulier sur le contenu de certains aspects du plan ministériel sur les valeurs de la République. Par rapport à cette loi, les soutiens les plus marqués viennent des répondants de l’UNSA et les plus hostiles de ceux de SUD, les répondants des autres syndicats sont en position intermédiaire. Alors que les militants de l’UNSA sont ceux qui indiquent leur plus fort attachement au concept de laïcité, ils sont un peu moins hostiles au financement de l’école privée que les adhérents de SUD, de la FSU et de la CGT Éducation. D’autre part CGC, CFDT et CTFC sont ceux qui marquent le moins de réticences face à cette disposition. Il est bon de rappeler ici que personne de FO et du SNALC n’a répondu.
Nous avons essayé ici tenté de dégager l’essence du contenu de cet ouvrage, d’autres points y sont décrits en dehors de ceux que nous avons sélectionnés. Ainsi peut-on relever un pessimisme moins marqué sur les résultats bénéfiques de l’action syndicale chez les militants de l’UNSA. Sa lecture se révélera utile à tout responsable syndical de quelque niveau que ce soit. Pour en tirer des perspectives d’action, les directions des organisations syndicales de la FSU, l’UNSA Éducation, la CFDT Éducation, et la CGT Éducation devront avoir accès à l’ensemble des données de cette étude d'Ismaël Ferhat car certains points restent à éclaircir.
Pour connaisseurs Aucune illustration