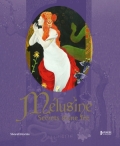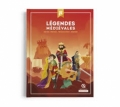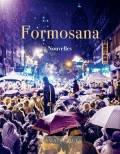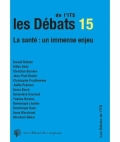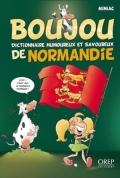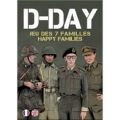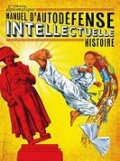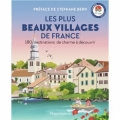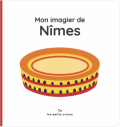Avis de Benjamin : "Jean Zay et Alain Savary au panthéon de la rénovation progressiste d’un système éducatif orienté actuellement vers la marche arrière"
Cet ouvrage propose les actes d’un colloque tenu au Sénat le 17 octobre 2024, ouvert par le sénateur du Nord Patrick Kanner et Bernard Toulemonde qui fut conseiller de Pierre Mauroy à Matignon et ancien recteur. La version en ligne est consultable là https://institutpierremauroy.fr/wp-content/uploads/2025/03/PDF_Colloque_2024.pdf et une version papier est à demander là https://institutpierremauroy.fr/nous-contacter/.
On doit se rappeler que Pierre Mauroy fut secrétaire du SNET-AA (de la Fédération de l’Éducation nationale) de février 1955 à 1958 car il était alors professeur de français-histoire-géographie dans l’enseignement technique, enseignant vraisemblablement à l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) de Cachan. D’autre part en 1975, Pierre Mauroy adressa un avertissement aux militants socialistes favorables à Unité et Action (tel Louis Mexandeau), Action syndicale (Stélio Farandjis) ou à Unité et Rénovation (comme Jean - Pierre Exbrayat) : « tout renversement de tendance [au sein de la FEN] entrainerait un affaiblissement du PS au profit de nos partenaires de l’union de la gauche ». Il invitait donc à soutenir la tendance UID. Pour l’action syndicale de Pierre Mauroy, on se reportera à un antre colloque Pierre Mauroy: Une passion syndicale et associative dont les actes sont consultables ici https://institutpierremauroy.fr/wp-content/uploads/2020/02/PM-passion-syndic-asso.pdf
On ne sera donc pas étonné de trouver ici un texte de Benoît Kermoal, membre du Syndicat des enseignants et directeur du Centre Henri Aigueperse UNSA Éducation. Cet écrit est intitulé "Proximité du syndicalisme de l’éducation avec les socialistes à travers l’histoire : renouer aujourd’hui avec « l’invincible espoir » ". Ce dernier rappelle que dans les locaux du Syndicat national des instituteurs fut signé en 1935 le programme minimal du Front populaire. Nous rajouterons que c’est dans les locaux du même syndicat, que de la propagande du PSA (ancêtre du PSU) et du cartel de l’Union des forces démocratiques (dont Denis Forestier secrétaire du SNI était un animateur), contre les premières années du gaullisme, furent imprimées.
Nous précisons que les dirigeants de la SFIO n'étaient déjà pas populaires au sein de la FEN, avec le système d'apparentement qui permit en 1951 à des voix socialistes de faire élire des démocrates-chrétiens du MRP et ceratins radicalisants hostile à l'école publique (d'où le vote des lois Marie et Barangé), le fait que Mollet et son entorage se rallient en 1958 à de Gaulle creusa un fossé plus grand entre la FEN et la SFIO. Les relations entre certains responsables de ces deux organisations furent donc parfois orageuses. Benoît Kermoal revient sur l’échec de la constitution d’un Grand service unifié et laïque de l’éducation (porté par le programme de François Mitterand en 1981). Il poursuit autour des questions de laïcité et d’amélioration du système éducatif.
Bernard Toulemonde revient lui aussi sur l’œuvre de Jean Zay (ministre de l’Éducation nationale sous le Front populaire) et parle de l’action d’Alain Savary au même ministère de 1981 à 1984 (ce qui est l’occasion de citer le rapport Legrand sur l’avenir souhaité des collèges). Il reparle de l’abandon du projet concernant l’intégration de l’enseignement privé dans un Grand service unifié et laïque de l’éducation. Il évoque également l’action de Lionel Jospin qui procède certes à une revalorisation des enseignants mais abandonne la création prévue dans le programme du PS d’un corps spécifique des professeurs des collèges (concession accordée au SNES) et rate une rénovation profonde du système éducatif à laquelle la FEN était prête. La conséquence du tout fut l’éclatement de la FEN fin 1992. Nous sont épargnées ici les atermoiements de Lionel Jospin (d'ailleurs un temps membre du SNESup) autour de la question du voile. Aucun participant à ce colloque ne se félicitera évidemment de l’idée de ce dernier, devenu Premier ministre, de choisir Claude Allègre comme ministre de l’Éducation nationale.
Bernard Derosier, qui fut instituteur et notamment secrétaire départemental de la FEN dans le Nord mais aussi député socialiste entre 1978 et 2012 avait ouvert ce colloque, il rappelle qu’il fut rapporteur du projet d’un Grand service unifié et laïque de l’éducation. Il remet en mémoire qu’à la Libération, le plan Langevin-Wallon fit l’unanimité à gauche.Le sénateur Patrick Kanner rend lui hommage à tous les ministres de l’Éducation nationale, sous le quinquennat de François Hollande. Il argumente sur le rôle que peut avoir le ministère en question dans la cohésion, l’égalité des chances et le développement des valeurs civiques.
Jean-Paul Delahaye, ancien inspecteur général, revient sur la création du baccalauréat professionnel par un ministre socialiste, tout en ayant la délicatesse de ne pas citer son nom (Chevènement) et trouve quelque grâce à l’action d’un autre ministre de l’Éducation nationale en évitant toujours de dire de qui il parle (Jospin). Par contre il donne le nom de Vincent Peillon et Najat Vallaud-Belkacem pour leurs actions en faveur de l’enseignement primaire, des REP+, la lutte contre le décrochage scolaire, l’enseignement moral et civique ainsi que la laïcité et la création de divers organismes. Par ailleurs il fait une critique en règle des actions sous le ministère Blanquer.
Avant de passer dans la fonction territoriale, Yannick Trigance a été enseignant et directeur à l’école primaire puis inspecteur de l’Éducation. Secrétaire national à l’Éducation au Parti socialiste, il développe l’idée que l’école est au cœur d’un projet de société porté par son mouvement. Ce dernier est bien sûr aux antipodes de celui qu’a porté Jean-Michel Blanquer. Il est dit de ce dernier qu’ »il renvoie à un véritable projet de société ultralibérale sur l’entre-soi, la compétition, contrairement à ce que nous portons nous, j’en reparlerai, l’altérité, la coopération, l’émancipation » (page 40). Il insiste pour que les enseignants retrouvent une liberté pédagogique qu’on leur a régulièrement grignotée sous la première présidence d’Emmanuel Macron (mais de Robien avait déjà ouvert le chemin), l’orientation en lycée professionnelle ne soit pas seulement par défaut, la mixité scolaire et le déclassement des enseignants dans la société.
Yannick Trigance finit son intervention en renvoyant à celle de Colombe Brossel, responsable de formation avant de devenir sénatrice de Paris. Celle-ci commence par exposer la proposition de loi de son groupe socialiste pour favoriser la mixité sociale au niveau scolaire et lutter contre les inégalités. Aujourd’hui 55% des enfants accueillis dans l’enseignement privé sont issus de classes socialement favorisée. Il s’agit de conditionner le financement de ce dernier au respect de la mixité sociale, ceci dans le cadre d’une grande rénovation de l’enseignement public (voir à ce sujet https://www.publicsenat.fr/actualites/education/le-senat-rejette-une-proposition-de-loi-socialiste-pour-renforcer-la-mixite-dans-les-etablissements-publics-et-prives).
Patrick Bloche, premier adjoint la mairie de Paris, dit qu’actuellement 37% des élèves entrant dans un collège parisien le font dans un établissement privé. Il propose de redéfinir la relation de l’État et les collectivités territoriales dans le domaine du système éducatif, sans laisser de côté les questions de pédagogie, de recrutement et formation des enseignants.
Pour tous publics Aucune illustration

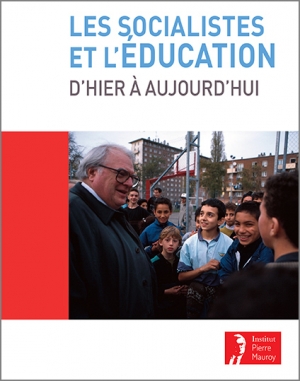




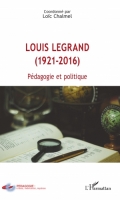


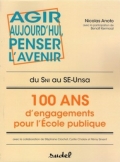
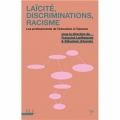

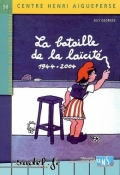


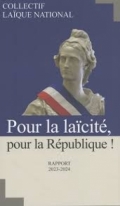

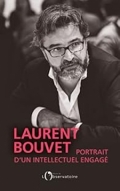
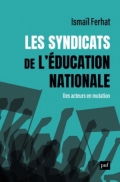









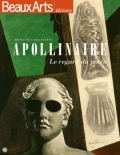







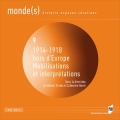
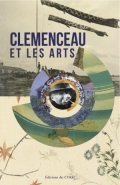
















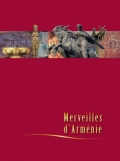





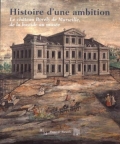


![Hors cadre[s], n°25 Hors cadre[s], n°25](/img/livre/collectif-hors-cadre-s-n-25_thumb.jpg)