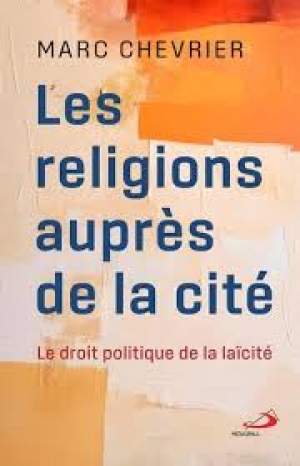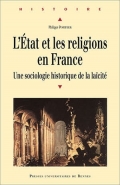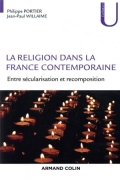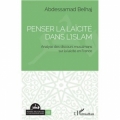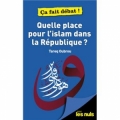Avis de Benjamin : "L’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu fit la cité terrestre (Saint Augustin)"
Cet ouvrage est sous-titré Le droit politique de la laïcité. L’auteur Marc Chevrier est écrivain et professeur au département de science politique à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches jusqu’à présent portaient sur le fédéralisme comparé, le gouvernement représentatif, les rapports entre droit et politique ainsi que sur les idées politiques au Québec.
L’ouvrage se propose d’éclaire le lecteur des dimensions historiques, philosophiques et juridiques portant le concept de laïcité. Ce dernier est le produit des relations complexes entretenues entre les religions et l’État ; celles-ci sont éclairées principalement (mais pas uniquement) par la situation française et québécoise.
Dans son introduction, Marc Chevrier avance que les déchirements dans l’univers de la chrétienté occidentale ont permis aux autorités politiques de progressivement renvoyer les Églises vers des tâches de plus en plus religieuses et les exclure des affaires des royaumes. Cependant « pour la fondation du droit politique, établir le rapport entre le pouvoir souverain et le pouvoir ecclésial ou religieux touche, non à l’accessoire, mais à une question préalable à toute discussion sur le gouvernement de la cité » (page 9).
Ce livre est composé de six chapitres. Le premier propose une récapitulation historique des questions théologico-politiques. Le second expose l’idée de laïcité telle qu’elle se décline sous diverses époques et différents pays. Le troisième compare, selon les États, la variété des régimes civils proposés aux religions. Le chapitre suivant a trait à la dimension philosophique du débat sur la laïcité avec un exposé des conceptions libérales, républicaines ou conservatrices. Pour cette dernière, la religion doit se maintenir dans l’espace public en développant ses valeurs et peut aller contre le mouvement global de sécularisation de la société.
Dans les débats autour des formes d’adoption de la laïcité au Québec, afin de promouvoir une laïcité dite "ouverte" (tenant compte de l’avis des religions sur certaines pratiques), il fut monté une vision tronquée de la laïcité française qualifiée de "républicaine". « Tout d’abord, elle viserait "l’émancipation des individus par rapport à la religion, et donc la sécularisation et l’érosion de la croyance religieuse". Une telle visée supposerait que l’adhésion à une religion serait "incompatible avec l’autonomie rationnelle des individus". Ensuite, autre défaut rédhibitoire de la laïcité "républicaine" française : elle chercherait l’intégration civique en exigeant l’effacement de la différence religieuse et des marqueurs identitaires, c’est-à-dire ethniques, de l’espace public. L’analyse des commissionnaires repose en fait sur une prémisse factuellement fausse, à savoir que le régime de laïcité ambitionnerait la "relégation stricte de la pratique religieuse aux confins de la vie privée et de la vie associative". Comme nous l’avons v, la France est loin d’interdire en soi les manifestations publiques et sociales de la religion ; au contraire, elle en garantit l’expression, sauf quand l’autorité de l’État est en jeu, car il est regardé en France comme le gardien de la chose publique, que ce soit dans l’exercice de ses fonctions régaliennes ou dans l’administration des services publics » (page 175).
Le cinquième chapitre s’intitule "Entre la justice et la prudence : la délicate saisie politique du religieux" et on pointe là certaines contradictions dont la moindre n’est pas que la sécularisation sociétale retrouve dans certains milieux une réaction religieuse identitaire absolutiste. Le dernier chapitre a pour titre "L’État contemporain et le conflit des masses spirituelles" ; les religions se vivent comme des sociétés souveraines ayant leurs propres traditions et valeurs, par ailleurs l’État les place sous sa surveillance (afin de contrer des dérives sectaires ainsi que des passages au terrorisme) et exige comme en France leur reconnaissance des valeurs de la République.
Dans sa conclusion, Marc Chevrier évoque la permanence de persécutions religieuses telle celle de musulmans en Birmanie (ou Myanmar), l’hostilité en Chine envers toute religion car il n’est pas toléré d’individus ne se référant à d’autres valeurs que celles affichées par le régime et il est craint l’apparition d’un contre-pouvoir (bien que non citée ici, je pense à la répression du Falun Gong, une discipline spirituelle qui réunit la pratique d’exercices physiques et la méditation), le retour du religieux en Russie patronné par le pouvoir (d’ailleurs en 2020 est inscrite la foi en Dieu dans la constitution du pays) pour promouvoir un contrôle social destiné entre autre à distinguer une société russe animée par le patriotisme et garante de valeurs oubliées par un Occident aux mœurs corrompues.
L’auteur propose dans les dernières pages des réflexions éclairantes sur les différentes mises à distance des religions selon certains pays. « Dans les sociétés où l’État a jadis commandité la persécution des minorités religieuses au profit de sa religion officielle, l’autonomie des religions a reçu une valeur parfois plus élevée que la séparation institutionnelle entre l’État et celles-ci. À l’inverse, là où contre l’État se dressait une Église qui lui disputait le monopole de la puissance, cette séparation s’est imposée comme la solution première à la paix civile et à l’unité nationale » (pages 392-393). « Pour les uns, cette neutralité signifie une absence de la religion dans l’État, qui doit apparaître, dans son fonctionnement, sa symbolique et la langue du droit, dépouillé de toute référence religieuse. Pour les autres, elle apparaît quand l’État, incorporant dans son giron toutes les confessions et les croyances, clame son impartialité vis-à-vis de chacune, de telle manière qu’il entretient tous les cultes ou leur accorde un traitement égal, par ses subventions et la visibilité admise de toutes les confessions au sein même des services publics. Dans la première manière, l’absence du religieux participe à la stature de l’État ; dans la seconde, son égale incorporation témoigne de sa proximité avec des représentants constitués de la société civile, animée par ses groupes religieux. Entre les deux manières, il y a bien sûr place à des formules intermédiaires (…) » (page 393). « Tout compte fait, les sociétés libérales ont retenu quelque enseignement de leurs querelles théologico-politiques, passées ou présentes. Deux grandes quêtes se sont livré bataille dans l’histoire : la soif de liberté, qui mène à la recherche de l’autogouvernement où s’affirme un agir collectif maîtrisé ; la recherche spirituelle, qui reconnaît à chacun la faculté d’emprunter des chemins inédits, tantôt secrets, tantôt exposés à la lumière publique, pour répondre aux interrogations de sa conscience et vivre les vérités qu’il pressent. Or, pour satisfaire à la fois ces deux quêtes, nous savons que politique et religion doivent apprendre à se dépendre mutuellement, sans s’ignorer l’une l’autre » (page 402).
Pour connaisseurs Aucune illustration