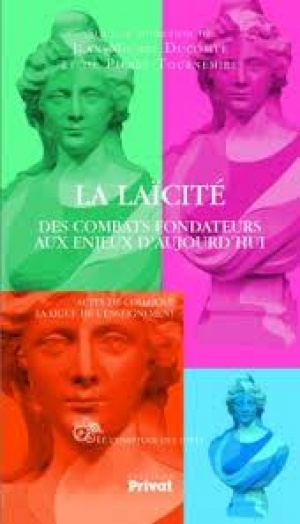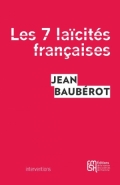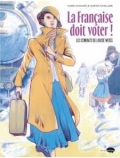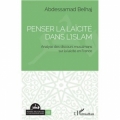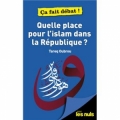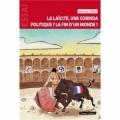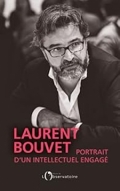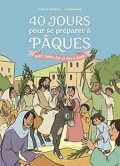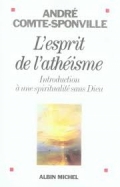Avis de Benjamin : "La laïcité, née dans le combat pour l’école, se décline en plusieurs écoles au XXIe siècle"
Ce livre est le fruit des communications tenues lors d’un colloque à Paris, à l’initiative de la Ligue de l’enseignement dans le cadre des 150 ans de la Ligue de l’enseignement. Le contenu se divise en cinq parties, la première traite de la laïcité comme une caractéristique fondamentale de la République, la seconde évoque la laïcité face aux défis des religions, la troisième porte sur les rapports de l’éducation et la laïcité, la quatrième parle de féminisme, genre et laïcité, la dernière pointe les rapports entre la laïcité et la conception du peuple portée par la laïcité. Sachant que le nombre de textes approche de vingt, notre choix est celui d’une sélection personnelle et des interventions délaissées pourront séduire d’autres lecteurs que nous-même. D’autre part vu la richesse du contenu de certaines que nous rapportons, nous avons dû relever certaines idées portées par elles et négliger certains sujets contenus dans celles-ci.
Jean-Paul Martin dégage quatre périodes historiques pour la Ligue de l’enseignement qui se crée en 1866 sous le Second Empire. La première est celle où Jean Macé milite pour la laïcisation de l’enseignement et demande un respect de l’athéisme sans exclure pour autant un déisme mais en demandant que les devoirs envers Dieu soient exclus des programmes. Durant tout le XIXe siècle, la Ligue compte de nombreux francs-maçons en son sein. Dans les années qui précèdent et suivent immédiatement la loi de Séparation, cette association soutient le vote de cette dernière loi et se centre également sur la solidarité, la science et le patriotisme. La troisième époque dure jusqu’en 1984, la Ligue milite pour une unification de l’enseignement scolaire. Avec la loi Barangé (1951), puis la loi Debré (1959), le financement de l’enseignement privé s’installe de manière durable.
Après l’échec du projet d’Alain Savary rassemblant l’école publique et l’école privée et l’affaire du foulard de Creil en 1989, la Ligue change d’orientation. Elle entend viser le libéralisme débridé et non plus le cléricalisme et considérer les religions comme des alliées potentielles dans ce combat. On passe alors à une laïcité d'un autre temps toutefois fidèle à la loi de Séparation. La dimension identitaire de la laïcité est gommée, la Ligue défend en priorité la liberté de conscience et d’expression pour une société basée sur l’égalité où le dialogue s’impose pour mener à une modération des revendications identitaires. La Ligue reste toujours pour la neutralité religieuse de l’enseignement.
Cependant le communautarisme pèse sur la société civile. Il paraît nécessaire d’ouvrir l’école à la logique de la société civile, c’est-à-dire à ne pas imposer la neutralité aux élèves. La laïcité débouche sur la libre expression multiculturelle et multi-religieuse, et cette liberté doit tendre vers l’unité de la chose commune. Face à « la fragmentation de la société civile (…) proie de tous les égoïsmes, des fanatismes, des racismes, des communautarismes (…) le fonctionnement des institutions publiques (…) est bouleversé » (page 35). Selon l’auteur, il y a deux réponses possibles, la première est de se ranger comme famille spirituelle (on a l’exemple de la Belgique où existe un Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles) en s’opposant essentiellement aux revendications islamiques (et non plus aux désirs des catholiques comme en 1905). Ce courant d’idées se traduirait par une réclamation d’ « une extension du principe de neutralité à de nouveaux espaces de la société civile, comme les crèches ou les espaces de loisirs collectifs des enfants et des jeunes ».
L’autre option choisie est celle de la Ligue. « Elle consiste à prendre à bras-le-corps les dissensus qui règnent dans la société multiculturelle. La laïcité est conçue ici comme un ensemble de principes et de valeurs (une combinaison de ressources juridiques ou éthiques en somme) permettant la confrontation pacifique pour surmonter les conflits de valeurs. Cette façon d’habiter la laïcité n’en fait plus l’affaire d’un seul État ou une notion définie seulement par rapport à l’État, mais une notion dont une multiplicité d’acteurs (associatifs notamment) peut s’emparer » (page 36). Le philosophe Paul Ricœur montre que « l’École occupe une position mitoyenne entre État et société civile, et qu’elle doit par conséquent faire cohabiter la laïcité d’abstention caractéristique du premier et la laïcité de confrontation découlant de la seconde. En suggérant cette articulation, Ricœur proposait non sans hardiesse d’ouvrir l’École à la logique de la société civile, à l’opposé de ceux qui, aujourd’hui, veulent étendre toujours plus la logique de neutralité des institutions publiques à la société civile » (page 37). Certains penseront par contre que dans cet exposé on ne sait pas quelles revendications identitaires la Ligue met sous le tapis ou entend remettre en question quand elles s’expriment dans l’école publique et quelle place elle entend voir tenir à l’école privée portée par des références religieuses diverses.
Dans la première partie, il y a aussi une communication d’Edwy Plenel pour qui la laïcité porte l’idée de faire peuple tous ensemble, d’où le droit de savoir (éducation) et la liberté de dire (liberté de la presse). La loi de 1905 a posé une logique de reconnaissance des minorités, de la diversité culturelle, de croyances et d’opinions. L’immobilisme de l’identité, mène surtout en situation de crise, à la désignation d’un bouc-émissaire essentialisé et donc à l’exclusion et à la discrimination. Il se révèle fondamental de « débloquer le pluriel » dans un grand « Un unificateur », contre l’identité de classe. Il rappelle une phrase de Zola, d’actualité non seulement en 2015 mais à notre avis encore plus particulièrement pertinente une dizaine d’années plus tard : « La République est envahie par les réactionnaires de tout genre. Ils l’adorent d’un brusque et terrible amour, ils l’embrassent pour l’étouffer » (page 72).
Galeb Bencheikh, dans son intervention "L’islam au risque de la laïcité", fait référence à la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983. Un moment où personnellement nous avons toujours pensé que la société française a raté le coche car on n’a pas répondu à son cri de mettre fin à la discrimination, ce qui a conduit au repli identitaire que nous connaissons aujourd’hui. Pour lui l’islam de France doit déculpabiliser les consciences (relativiser certains interdits religieux), dégraisser le sacré (aller à l’essentiel dans la masse des prescriptions coraniques), accompagner les esprits (vers une contextualisation des injonctions), réfléchir sur la constitution du droit (distinguer ce qui vient de Mahomet de ce qui a été construit après). Valentine Zuber rejoint Edwy Plenel sur l’idée que la laïcité ne peut s’exercer que dans la limite de l’égalité réelle, contre la dictature de la majorité. Par ailleurs la laïcité garantit enfin la liberté d’expression pour tous, avec toujours à l’esprit le respect de la liberté de chacun.
Dans la troisième partie, Françoise Lorcerie présente le dispositif des formations à la laïcité mis en place en 2015 dans l’académie d’Aix-Marseille. Il ne s’agit plus de transmettre les valeurs de la République, mais d’en débattre pour les faire partager. La laïcité est perçue par nombre d’élèves comme une collection d’interdits. On ne doit pas faire passer la charte de la laïcité et les valeurs de la République comme une démonstration d’une exemplarité de la France qui n’existe pas et qui existe encore moins dans certains espaces du territoire national. Laurence de Cock rejoint assez souvent les préoccupations de Françoise Lorcerie. Pour elle, l’enseignement moral et civique a été détourné après les attentats de 2015, comme une nécessité de faire adhérer les élèves aux valeurs de la République (obéissance et soumission). La culture du conformisme doit céder la place à une culture du conflit et du débat.
Pour le quatrième ensemble, Florence Rochefort réfléchit sur le lien entre laïcité et féminisme. L’égalité des sexes n’est pas constitutive de la laïcité mais elle est devenue progressivement un garant historique de l’émancipation des femmes. Nicole Mosconi nous surprend fort en écrivant que l’Église était opposée au droit de vote des femmes ; ce sont en effet les catholiques qui sont quasi unanimes à le réclamer en France durant l’Entre-deux-guerres en comptant bien que leurs voix renforceront les partis qui défendent les idées cléricales alors que ce droit est bloqué par les radicaux qui sont souvent autant farouches laïques que conservateurs sociaux. La subordination des femmes dans le mariage a été longtemps une pratique où nombre de laïques se retrouvaient avec les catholiques. Par contre en effet le droit à la contraception puis à l’IVG ont rencontré l’opposition de l’Église. De nos jours certains milieux catholiques se sont montrés très actifs tant dans leur opposition au mariage pour tous, que dans leur critique d’une prétendue théorie du genre ou le contenu de l’éducation sexuelle à l’école. Malika Hamidi, docteur en sociologie, évoque le féminisme musulman. Ce dernier renvoie à la fois contre le sexisme dans la société musulmane et contre le racisme dans le monde occidental. Le mouvement du féminisme musulman est particulièrement présent dans le monde anglo-saxon. Il questionne la théologie musulmane en demandant une réinterprétation des textes la portant. Deux questions se posent à nous la première est la relation que ces musulmanes féministes européennes ou américaines entretiennent avec celles qui prétendent se libérer en portant le foulard et les liens qu’elles ont avec les femmes musulmanes vivant dans des pays où l’islam est la religion officielle.
Dans la dernière partie, la militante associative Nadia Azoug invite à découvrir des réalisations de son association à http://remembeur.com. Nicolas Cadène avance que la laïcité est parfois perçue comme un outil de ségrégation indicible et d’un rejet culturel tout en renvoyant à un passé mythique. « Par la laïcité, il s’agissait de construire une citoyenneté commune, quelles que soient nos appartenances propres » (page 220). La laïcité n’est pas un outil d’oppression mais un moyen d’émancipation qui garantit un cadre de bonne entente pour des croyants de diverses origines et des athées. « La laïcité ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société, tels que les discriminations, l’absence de mixité sociale, l’incivilité, la sécurité publique, le terrorisme, etc. »(page 221). Une action publique ambitieuse et une éducation populaire conséquente sont la clef de la construction de la citoyenneté pour Nicolas Cadène.
Pour connaisseurs Aucune illustration