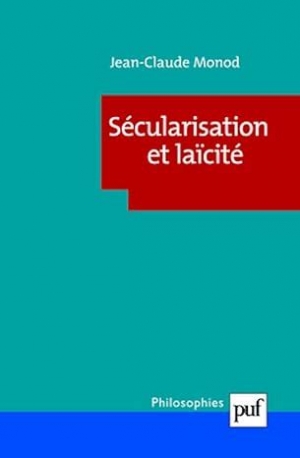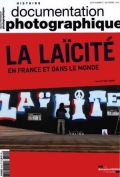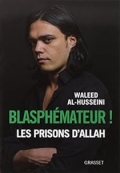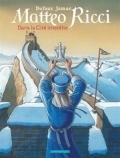Avis de Benjamin : "Alors j’ai pensé que Dieu était encore mort, ou qu’il avait baissé les bras (Vivons heureux en attendant la mort de Pierre Desproges)"
Jean-Claude Monod est le fils de l'ethnologue Jean Monod mais n’aurait pas de lien familial proche avec Théodore Monod. Il enseigne au département de philosophie de l’École normale supérieure au moment de la sortie de cet essai. Rappelons que la sécularisation est le processus qui a réduit l’influence de la religion dans les sociétés et que la laïcité est la neutralité de l’État en matière des cultes. Dans son essai La querelle de la sécularisation paru chez Vrin en 2002, Jean-Claude Monod distinguait la sécularisation-liquidation qui prétend pouvoir détruire l’héritage religieux pour initier de nouvelles formes de pensée de la sécularisation-transfert qui soupçonne tous les concepts politiques de n’être rien d’autre que des concepts théologiques sécularisés, et de la sécularisation-neutralisation mise en évidence par le sociologue Max Weber comme ayant l’objectif d’assurer la liberté de conscience en ôtant à la puissance publique les idées d’une action en direction de la religion, ceci en étant porteur d’une voie libérale.
Au début de son essai, Jean-Claude Monod expose ce qui va servir au développement de sa réflexion. « Si on aborde le problème à travers le prisme des liens entre la sécularisation et la laïcité, plusieurs points peuvent être posés d’emblée, que nous étaierons par la suite:
1) la laïcité est le produit politique du processus historique de sécularisation, elle en est le résultat institutionnel-ou, du moins l’un des résultats institutionnels
2) la laïcité est une variante de la sécularisation comme forme générale des sociétés occidentales modernes
3) la laïcité française a ses spécificités, inscrite dans une histoire singulière (...)
On peut ainsi caractériser la spécificité de la laïcité par rapport à d’autres régimes de sécularisation de différentes façons, qui peuvent se charger d’appréciations laudatives critiques:
1) la laïcité est une sécularisation conséquente accomplie ou "radicale", poussée jusqu’à sa conséquence logique dernière, la séparation des Églises et de l’État ;
2) la laïcité est une variante de la sécularisation marquée par le rôle prépondérant de l’État comme garant de la constitution d’un espace public "neutre" » (pages 7-8)
Il poursuit ainsi : « À cet égard, les points qui suivent relèvent davantage d’hypothèses d’interprétation du présent, que ce petit livre voudrait développer:
1) la laïcité fait aujourd’hui l’épreuve d’une pression contradictoire, émanant à la fois de la poursuite du processus de sécularisation et de mouvements inverses, et puissants, de "contre-sécularisation"
2) le processus de sécularisation se poursuit à certains égards, et la laïcité en est elle-même affectée, en ce qu’elle se trouve concentrée à l’érosion de son socle de justification civique-républicaine et à la progression de son pôle libéral-individualiste que l’on peut référer à un mode "protestant" de "sécularisation"
3) cependant, on assiste par ailleurs à un redéploiement du religieux, et de nouvelles formes de théologies politiques se composent aujourd’hui contradictoirement avec ce processus de sécularisation qui se poursuit sous certains aspects. La laïcité est ici confortée au même titre que d’autres formes institutionnelles de sécularisation mais peut-être avec une véhémence particulière, à une contestation frontale, qui naît de formes de religiosité pour lesquelles la participation entre pouvoir séculier et pouvoir régulier, doit être mise en question » (page 10).
L’ouvrage est dévisé en trois grandes parties. La première est un exposé sur les raisons qui ont conduit à la sécularisation dans les pays occidentaux. Avec le protestantisme, il y a eu une désacralisation des rites religieux ; ceux-ci ont perdu une grande partie de leur dimension magique. Dans le même temps la foi s’individualisait et l’ascétisme n’était plus réservé qu’aux seuls moines. La seconde partie s’attache à l’approche de différentes voies nationales qui ont mené à la sécularisation en France, Angleterre et USA.
Le dernier volet revisite les principes de la laïcité. Des dérives scientistes ont existé par la sacralisation de l’idée de progrès au XIXe et au début du XXe siècle. Si l’islam, dans ses origines, a bouleversé les sociétés traditionnelles des sociétés où il se propage dans un sens largement égalitaire dans un premier temps, il a figé les sociétés musulmanes dans un second temps en refusant la contextualisation des préceptes, en décrétant le Coran incréé et instituant une théocratie.
Des conséquences brutales de la mondialisation ont parfois laissé percevoir le message laïque comme un outil destructeur des univers culturels non occidentaux par des populations locales, d’où certaines réaction. Pour l’auteur, une laïcité radicale s’est dégagée en France en réaction à l’expression de certains intégrismes, elle peut devenir une doctrine d’État qui véhicule que l’islam est incompatible avec la République. Toutefois elle est le fer de lance de toute les essais de limiter la liberté d’expression, de caricature et de pénaliser le blasphème par un prétendu respect des religions. Dans sa conclusion, Jean-Claude Monod affirme que ce n’est que dans le cadre d’une société laïque « qu’une conscience critique peut réellement exercer tous les droits d’examen et d’"ironie" à l’égard des pouvoirs et des dogmes établis, et qu’une démocratie laïque est la meilleure garantie de l’égale liberté des consciences » (pages 151-152).
Réservé aux spécialistes Aucune illustration