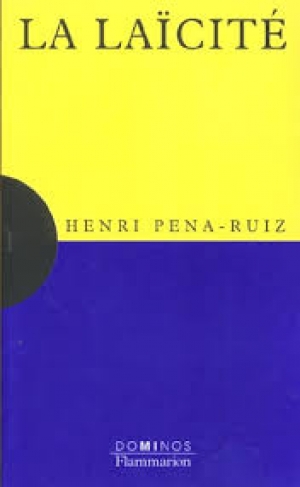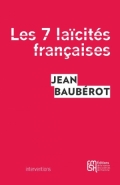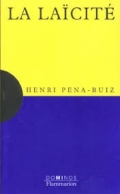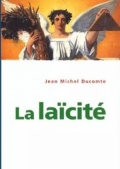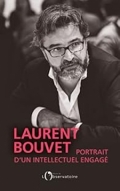Avis de Benjamin : "La laïcité n'est pas un particularisme accidentel de l'histoire de France, elle constitue une conquête à préserver et à promouvoir, de portée universelle"
Henri Peña-Ruiz est né le 22 avril 1947 au Pré-Saint-Gervais, commune limitrophe de Paris. Agrégé de philosophie, il soutient en 2002 une thèse intitulée La Philosophie de la laïcité. La même année, il est nommé par Jack Lang, alors ministre de l’Éducation nationale, membre du Comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l'école (un organisme éphémère disparu sous le mandat de Nicols Sarkozy). Soutien de Jean-Luc Mélenchon en 2017, il prend ses distances avec LFI deux ans plus tard ne partageant vraisemblablement pas certaines positions du premier autour de la laïcité.
De l’avant-propos, on retiendra : « La laïcité concerne le principe d’unification des hommes au sein de l’État. Elle suppose une distinction de droit entre la vie privée de l’homme comme tel et sa dimension publique de citoyen : c’est en tant qu’homme privé, dans sa vie personnelle, que l’homme adopte une conviction spirituelle, religieuse ou non, qu’il peut bien sûr partager avec d’autres. Mais, de cela, la puissance publique n’a pas à s’inquiéter tant que l’expression des convictions et des confessions reste compatible avec le droit d’autrui » (page 9).
L’ouvrage est divisé en deux grandes parties : "Un exposé pour comprendre" et "Un principe de concorde". La première situe la laïcité dans sa dimension juridique et philosophique mais aussi par rapport aux conflits dus à la résistance à sa reconnaissance par l’Église catholique et dans les liens qui existent entre le politique et le religieux. La seconde division du livre s’attachera à poser l’idéal laïque face aux replis identitaires des communautarismes et de l’internationalisation des valeurs marchandes.
Dans le premier volet, certaines phrases sont à relever. « Si la laïcité délie la conscience des hommes pour que ceux-ci s’unissent librement, elle ne les voue pas pour autant à l’anarchie et au relativisme intégral qui installeraient le règne du rapport de forces. Il y a bien des valeurs laïques, ou si l’on veut des principes, qui procèdent d’une conception exigeante de la dignité de l’humanité. Liberté de conscience, égalité de droits, bien commun par delà les différences, confiance de principe dans l’autonomie, affirmation simultanée de la souveraineté de la conscience individuelle, et du peuple sur lui-même c’est tout un idéal qui retentit dans le mot "laïcité" » (page 20). Henri Peña-Ruiz poursuit en évoquant l’incompatibilité entre la laïcité et un pouvoir confessionnel voulant régenter toute la société. Il s’agit là du cléricalisme qui fonctionne intrinsèquement au détriment de la liberté de conscience ainsi que de l’égalité éthique et juridique.
« L’esprit réside sans doute dans la foi, mais il vit également dans la pensée rationnelle, l’activité créatrice de l’artiste et, plus généralement, dans la culture. La religion n’a donc pas le monopole de la spiritualité » (page 22). Henri Peña-Ruiz parle ensuite d’un pouvoir spirituel qui est un cléricalisme. « La religion, comme croyance unissant librement des fidèles, ne peut ni ne doit être confondue avec le cléricalisme, ambition toute temporelle de domination s’incarnant concrètement dans la captation de la puissance publique » (page 23).
L’auteur rappelle que le christianisme, depuis qu’il est devenu en 380 la religion officielle de l’Empire, a persécuté des populations entières ou des individus (certains pour leurs écrits, d’autres pour blasphème. On a pu dire caricaturalement que les lumières du christianisme sont celles des bûchers, a contrario, la laïcité se veut fille des Lumières. L’esprit de cette dernière veut aller au-delà de la tolérance, aucune religion ou idéologie ne vient prendre une place privilégiée laissée vacante.
L’image de Marianne au fronton d’une mairie ouvre la seconde partie de l’ouvrage. Il s’attache à montrer que, pas plus que la France est fille aînée de l’Église, la laïcité est fille du christianisme. Certes ce dernier parle de deux royaumes, celui de César et celui de Dieu, mais il a une visée universaliste. De plus « Pascal, disciple fidèle de saint Augustin, ne situait l’égalité des hommes qu’au niveau de leur finitude d’êtres créés, et entérinait parallèlement les hiérarchies sociales existantes. C’est à l’idéal des Lumières, précédé et préparé par l’humanisme rationaliste de toute la tradition philosophique, que revient d’avoir construit le modèle politique et juridique de l’égalité et des droits de l’homme » (page 75). Dans le même ordre d’idée, Henri Peña-Ruiz rappelle qu’encore en 1864 Pie IX déclarait les droits de l’homme impie. Ajoutons personnellement que l’évolution date des années 1960, dans le sillon de Vatican II, quand l’Église découvrit que sa perte d’influence voire sa répression pouvait être amortie en se réclamant des droits de l’homme.
Dans un chapitre de cette seconde partie, l’auteur avance que certains essaient de redéfinir la laïcité en la dénaturalisant, pour lui on ne doit pas évoquer les termes de "laïcité ouverte" ou de "laïcités plurielles". Il est toutefois dommage que Henri Peña-Ruiz ne donne pas derrière le contenu de cette conception de façon explicite. Selon certains, la laïcité ouverte se traduit par la liberté pour les croyants de pratiquer leur religion et d’assumer leur identité religieuse, y compris dans la sphère publique sans restriction autre que le trouble à l’ordre public. Concrètement en particulier, les élèves peuvent venir à l’école publique avec des signes religieux ostensibles et les agents des fonctions publiques peuvent afficher leur foi.
Cela nous amène personnellement à quelques questions. Pour les fonctionnaires musulmans, cela irait-il jusqu’à s’absenter pour une prière rituelle et à jeuner jusqu’à être indisponible pour assurer leur tâche dans de bonnes conditions ? Pour les fonctionnaires sikhs cela se traduirait-il par le port du poignard ? Pour Arkadiusz Kozelak-Maréchal, cadre de santé formateur à l’IFSI du CHU de Rouen, dans son livre Religion, spiritualité, laïcité et soin, il s’agirait alors de « naturaliser la religion dans les soins, au sens de la rendre à nouveau familière et naturelle, en tant qu’un phénomène humain parmi d’autres, afin de lui redonner une place dans les soins et de s’en servir. Autrement dit, il s’agirait de penser la religion comme un outil thérapeutique ».
Henri Peña-Ruiz affirme que cette laïcité ouverte permettrait le retour de la sanction pour blasphème. Toute critique d’une croyance serait condamnable. Dans un chapitre sur l’école, notre auteur désire des programmes étrangers à toute croyance religieuse, faisant droit « aux exigences de la connaissance et de la réflexion critique » (page 96). Il conclut ainsi ce chapitre, et par la même occasion, son ouvrage « La générosité laïque consiste à créditer tout homme d(une richesse de possibilités toujours plus grande que celle qu’il peut manifester dans les limites d’une situation donnée. C’est pourquoi rlle est solidaire d’une conception dynamique de l’émancipation, où l’accès à l’universel se conçoit comme construction patiente de ce qui unit les hommes par le haut, selon l’idée de leur accompagnement le plus abouti. Au cœur de cette construction vit le travail de raison, faculté de penser lucidement les fins humaines ainsi que les fondements éthiques et politiques de la concorde. Le souci de l’universel n’appelle alors aucun reniement, mais une culture de la distance réflexive qui permet de retrouver ce qui, essentiellement, fonde l’unité de l’humanité. Ainsi se trace le programme de la fraternité » (page 111).
Pour connaisseurs Peu d'illustrations