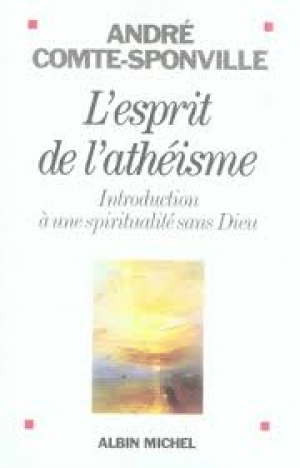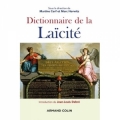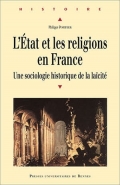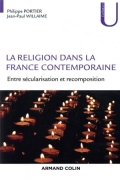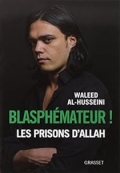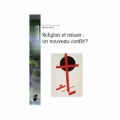Avis de Benjamin : "Contrairement à Malraux, André Comte-Sponville pense que le XXIe siècle sera spirituel et laïque ou ne sera pas"
J’ai toujours cru spontanément qu’André Comte-Sponville appartenait à la famille d’Auguste Comte et la lecture de cet ouvrage m’a amené à chercher à le vérifier, ceci m’amenant à découvrir que ce n’était pas le cas. Cet essai est sous-titré Introduction à une spiritualité sans Dieu. Il se divise en trois parties : "Peut-on passer de religion ?", "Dieu existe-t-il ?" et "Quelle spiritualité pour les athées ?". Les deux premières ont pour objectif sous-jacent de favoriser la compréhension des ressorts de la troisième question et donc d’y répondre.
André Comte-Sponville prend soin de bien définir notions et concepts, les références historiques sont pertinente, la pensée est fluide. La spiritualité, c’est la vie de l’esprit. La religion n’est qu’une de ses formes. L'auteur se montre respectueux vis-à-vis des spiritualités se rattachant à l’existence d’un Dieu. D’autre part il glorifie la tolérance, la morale et l'amour.
L’auteur avance que Dieu a été inventé par les hommes, ces derniers désiraient donner une finalité au monde existant ainsi qu'un sens à leur vie et à leurs souffrances. La religion (certains lui prêtent comme étymologie "ce qui relie") permet à une société de dégager les mêmes valeurs, de trouver un but commun et d’assure une cohésion d’une société.
Dans la deuxième partie, André Comte-Sponville donne ses raisons personnelles pour lesquelles il ne croit pas en Dieu. Il recense la faiblesse des preuves (ontologique, cosmologique, physiquo-théologique), la faiblesse des expériences (Dieu ne communique pas ou peu dans des circonstances discutables avec les hommes), les explications théologiques qui en tant que mystères de la foi échappent par définition à tout raisonnement, la multitude des souffrances frappant les hommes et les innombrables formes que prend le mal, les motivations négatives d’action chez l'homme, et enfin l’image d’un Dieu répondant à nos désirs. Un Dieu, plein d’amour et de miséricorde, apporte un soutien (peut-être fantasmatique) au croyant. De plus croire en Dieu, c’est croire en une vie sereine après la mort où on retrouverait même peut-être les âtres aimés tout au long de sa vie.
Dans la dernière partie, l’auteur propose une spiritualité en l'absence de Dieu. Être athée, c’est croire que Dieu n’existe pas. André Comte-Sponville prône la laïcité comme moteur de la séparation du spirituel et du politique. Il puise certaines valeurs dans certaines religions comme la compassion avec le bouddhisme, le détachement des biens matériels avancé par plusieurs cultes, la fraternité élargie des croyants d’une religion particulière à tous les hommes, l’humilité recommandée également dans certaines religions. L’athée, mue par une spiritualité, entend agir pour la justice, pour la paix, pour l’amour, pour une certaine conception de la vie et de l’humanité. On est là dans une perspective d’ouverture aux autres, au monde, à l’infini. si Dieu n’existe pas, tout doit être fait pour réaliser les valeurs des Lumières.
On retiendra des phrases de l’auteur :
« L’agnostique et l’athée ont en effet en commun – c’est pourquoi on les confond souvent – de ne pas croire en Dieu. Mais l’athée va plus loin : il croit que Dieu n’existe pas. L’agnostique, lui, ne croit en rien : ni que Dieu existe, ni qu’il n’existe pas. […] Personne ne sait, au sens vrai et fort du mot, si Dieu existe ou non. Mais le croyant affirme cette existence (c’est ce qu’on appelle une profession de foi) ; l’athée la nie ; l’agnostique ni ne l’affirme, ni ne la nie : il refuse de trancher ou s’en reconnaît incapable. […] La différence entre l’agnostique et l’athée, ce n’est donc pas la présence ou non d’un prétendu savoir. Heureusement pour les athées ! Si vous rencontrez quelqu’un qui vous dit : « Je sais que Dieu n’existe pas », ce n’est pas d’abord un athée, c’est un imbécile. Et même chose, de mon point de vue, si vous rencontrez quelqu’un qui vous dit : « Je sais que Dieu existe ». C’est un imbécile qui prend sa foi pour un savoir ».
« La vie est d’autant plus précieuse qu’elle est plus rare et plus fragile. La justice et la paix, d’autant plus nécessaires, d’autant plus urgentes que rien ne garantit leur victoire. L’humanité d’autant plus bouleversante qu’elle est plus seule, plus courageuse, plus aimante ».
Pour connaisseurs Aucune illustration