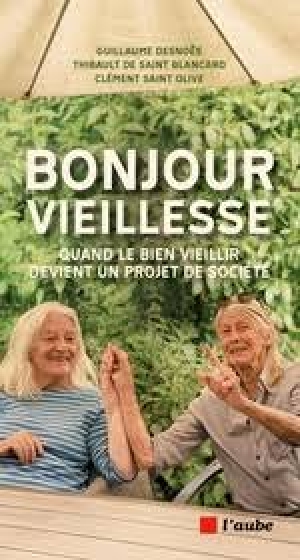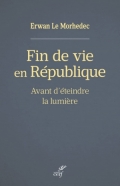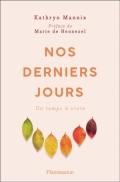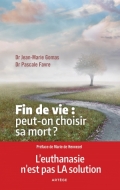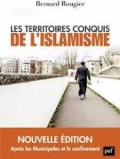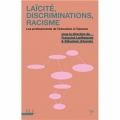Avis de Patricia : "Bonjour vieillesse, adieu tristesse"
Cet ouvrage est sous-titré Quand le bien vieillir devient un projet de société. Le texte ouvre sur la mauvaise image de marque des EHPAD (avec entre autre des difficultés de recrutement du personnel), leur équilibre financier bien compromis et le papy boom qui a commencé à se dessiner. Déjà en 1970 Simone de Beauvoir, dans son essai La vieillesse, pointait que notre société « abritée derrière les mythes de l’expansion et de l’abondance […] traite les vieillards en parias ». Ce livre se donne pour mission de rapporter de nombreuses initiatives qui entendent faire du grand âge « un temps d’apaisement, de sagesse et d’accomplissement personnel » (page 13). Il semblerait qu’un certain nombre d’actions innovantes soient d’ailleurs régulièrement rapporté dans la revue Vieux, lancée récemment par Antoine de Caunes.
En 1977 le livre Il y a toujours des hospices de vieux (signé notamment par le sociologue Bernard Ennuyer) évoquait les deux cas particuliers d'établissement de Nanterre et d'Issy-les-Moulineaux où existaient de grands dortoirs qui accueillaient près d’un millier de personnes. La création des EHPAD fut donc une marche vers le progrès. Toutefois dans ceux-ci «le fossé se creuse entre le travail prescrit, c’est-à-dire tel qu’il est imaginé et enfermé dans des normes et réglementations, et le travail réel, qui reflète la vie vécue sur le terrain, dans les établissements ou à domicile » (page 26). Le projet de vie n’encourage pas à la prise d’initiative pour améliorer la qualité de vie du résident et la signature d’une charte de bientraitance par les soignants n’est pas une garantie contre la maltraitance devenant récurrente en partie du fait des conditions de travail des professionnels. « Si quelqu’un de bien intentionné finit par avoir un comportement inadapté dans une situation donnée, c’est pour de multiples raisons potentielles : un manque de formation, un manque de temps, un manque d’informations, un manque de sens au travail, etc » (page 28). Pour les auteurs, la multiplication des normes bride les initiatives mais la remarque qui s’étonne que l’on ait pu envisager de faire rendre compte par les EHPAD du nombre de douches hebdomadaires quand on sait que pour les personnes non autonomes, dans ce type d’établissement, l’usage est d’une douche par semaine (les autres jours, elles ont droit à une rapide toilette au gant).
Les auteurs rappellent que dans un précédent livre La société du lien,ils avaient expliqué comment les métiers du grand âge « avaient été pensés comme une "commodité "», une somme de gestes techniques à exécuter, mécanique ment, pour répondre, justement, à ce besoin de prise en charge. Les professionnelles concernées ont ainsi été confinées dans des "cases", chacune correspondant à une tâche prédéfinie et limitée. Une sorte de taylorisation appliquée aux services qui n’a pas seulement conduit à rigidifier le fonctionnement global et à cadenasser l’esprit d’initiative, mais a contribué à précariser les conditions de travail, avec un émiettement des tâches, des emplois du temps morcelés, des organisations de vie impossibles, notamment dans l’aide à domicile » (page 33).
En conséquence « passer de la "prise en charge" au "bien vieillir" est une façon de remettre en cause certaines conceptions datées sur le sens même de la relation d’accompagnement, sur la relation entre aidants et professionnelles souvent trop marquée par le consumérisme, sur le cadre réglementaire qui nous rassure mais nous empêche à la fois, sur notre conception tayloriste des métiers. L’objectif est ambitieux (certains diront assez utopique) puisque « généraliser le bien vieillir, ce n’est pas simplement changer notre façon de considérer et de traiter la question du grand âge: c’est changer radicalement la société dans son ensemble » (page 37).
Le second chapitre se nomme "Chroniques des prémices de la société … du bien vieillir en 2025 Exploration des pouvoirs de la rencontre, de la vulnérabilité et de la coresponsabilité". On présente là des exemples de démarches quelque peu innovantes comme une crèche s’installant au sein des Ehpad, l’implication de résidents dans diverses tâches et de soignants aux tâches diversifiées dont celle d’animation, la venue de jeunes en service civique dans les EHPAD ou chez des personnes hospitalisées à domicile…
Plus loin, on le projet « Équilibres » ‒ qui signifie ÉQUipes d’Infirmières LIBres REsponsables et Solidaires: cette expérimentation est lancée par l’État qui veut favoriser l’émergence de nouvelles solutions pour améliorer le système de santé. La particularité de cette expérience consiste à rémunérer ces infirmières pour le temps passé à domicile et non pour chaque acte. Dit autrement, et dans des termes plus spécifiques, on parle d’"approche globale" est pas un et change tout: on ne s’intéresse plus à la maladie d’une personne mais bien à la personne en tant que telle, avec le postulat qu’en procédant ainsi on améliorera sa santé (pages 63-64).
Sont mentionnés également « d’initiatives (qui) s’appuient déjà sur la coresponsabilité, dans les habitats partagés notamment mais aussi dans de nombreux Ehpad qui s’attellent à changer radicalement la nature de leurs relations avec les familles, en leur permettant de dialoguer régulièrement avec les professionnelles (page 69). Il est aussi question d’impliquer les familles dans certaines tâches matérielles pour créer du lien. Il y aussi des EHPAD qui mettent à disposition une chambre pour un étudiant en échange de séquences temporelles passées auprès des résidents. Des EHPAD proposeraient à prix réduits des aliments issus de plats non consommés par les résidents ; le fait qu’il soit délaissé par les résidents interroge selon nous... D’autres ouvrent un restaurant afin de s’ouvrir sur des personnes extérieures.
"2035 dans la société du bien vieillir" est l’intitulé du troisième chapitre. Ce sont des fonctionnements souhaitables dans le futur qui sont exposés. On peut qu’être d’accord avec ce qui est énoncé ci-dessous: « À la base, un constat simple : l’accompagnement d’une personne âgée devient beaucoup moins complexe quand celle-ci a une meilleure estime d’elle-même et se sent porteuse d’une utilité sociale. Un principe qui s’applique également aux établissements : quand ils se mettent en position de rendre des services à leur voisinage, beau coup de problèmes deviennent moins difficiles à régler » (page 80). Il faut donc créer des situations d’activités authentiquement utiles à d’autres personnages et inviter des associations à s’impliquer dans des temps de présence (notamment celles qui proposent des cours de français à des migrants). Par ailleurs les professionnels doivent mieux intégrer le sentiment d’empathie dans leurs pratiques.
Dans la conclusion, il est écrit qu’actuellement le coût de l’accompagnement du grand âge est de 35 milliards d’euros par an pour l’État, soit 1,2 % du produit intérieur brut ; il est certain qu’il va croître. L’innovation sociale est nécessaire tant pour limiter les coûts que pour promouvoir une société du bien vieillir. Le problème est qu’une multitude de prises de conscience suivies d’actions déterminées doivent émerger pour provoquer un changement global conséquent dans le vécu des résidents d’EHPAD. En annexe, on invite les professionnels intervenant auprès du grand âge à réfléchir sur des actions qui pourraient figurer dans un Manifeste du bien vieillir. Afin de stimuler des idées de contenu, il est proposé un modèle se déclinant en cinq principes, ils sont illustrés concrètement par des actions de terrain et des actions publiques. Ces derniers sont :
- permettre aux personnes âgées, quel que soit leur état de santé, d’exercer leur libre choix, d’interagir avec les autres générations, d’avoir une utilité sociale et donc un impact positif sur l’ensemble de la société
- développer un cadre réglementaire au service des problématiques réelles du terrain
- favoriser la coresponsabilité entre les aidants professionnels et les aidants familiaux
- valoriser les métiers du prendre soin, en faisant de l’empathie et des soft skills des compétences clés valorisées dans le champ professionnel et culturel
- engager les acteurs du secteur à produire de l’impact positif au service des personnes âgées et de l’ensemble de la société
Pour tous publics Aucune illustration