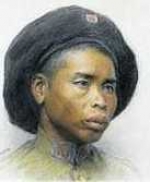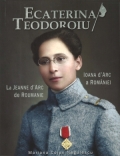Avis de Octave : "Désunis, nous courrons à la catastrophe. Unis, nous y parviendrons. (Cioran)"
L’auteure est née à Bucarest le 25 juin 1954, elle s’exile en 1973 avec son père en Suisse ; elle a déjà livré trois biographies (sur Anouilh, Orson Welles et Alberto Giacommetti) ainsi que des romans, livres de littérature de jeunesse, pièces de théâtre (dont une autour de Chanel). Anca Visdei entend répondre au vide biographique remarqué par l’édition des œuvres d’Emil Cioran dans la Bibliothèque de la Pléiade. Elle informe par contre que les commentaires sur la production littéraire de Cioran sont légions. Ceci alors que Cioran déclarait que « tout commentaire d’une œuvre est mauvais ou inutile, car tout ce qui n’est pas direct est nul » (page 10). En annexe, on trouve l’article d’ romans, livres de littérature de jeunesse, pièces de théâtre (dont une autour de Chanel). Anca Visdei (pour Les Nouvelles littéraires de février 1986) où elle évoque son entretien avec Cioran.
Cioran est né en 1911 en Transylvanie alors en Hongrie, il est donc, dans sa prime enfance, sujet de la double monarchie. Il est le fils d’un prêtre orthodoxe et dans sa famille on a compté des boyards. Son grand-père maternel avait été anobli par l’administration hongroise, il était notaire. Emil Cioran a pour grand-oncle Dimitrie Comşa, enseignant agronome, homme politique et membre de l’Académie roumaine qui décède en 1931. Emil Cioran et ses frères et sœurs sont confiés, pour environ deux ans, à leur grand-mère maternelle lorsque ses parents ont des problèmes avec les gendarmes hongrois qui les ont accusés de séparatisme durant la Première Guerre mondiale.
Emil Cioran fait des études au lycée de Sibiu pour huit ans, ville très majoritairement habitée par des gens d’origine allemande. Il apprend le violon et comme sa mère il gardera un grand goût pour la musique classique. Il prend goût à la philosophie dès l’âge de quinze ans.
Il s’inscrit ensuite à l’université de Bucarest. Emil Cioran a pour enseignant, au début des années trente, le charismatique Nae Ionescu « animé de prétentions mystiques, messianistes et philosophiques mâtinées de folklore roumain et de religion orthodoxe » (page 54). Tous les étudiants de ce dernier sont séduits par ses discours, à l’exception notable d’Eugène Ionesco et de l’écrivain Milhail Sebastian.
En 1933, notre personnage part pour Berlin puis un temps à Munich et écrit en roumain son premier livre Sur les cimes du désespoir l’année suivante. Peur de la mort et peur de la folie l’habitent alors. Il est d’abord séduit alors par l’ordre que les nazis imposent à l’Allemagne. Toutefois « en février 1935, il reconnaît que l’idéologie nationale-socialiste est bornée et particulariste, que la littérature hitlérienne est illisible, que le niveau intellectuel de l’Allemagne est bas et que le national-socialisme est un attentat contre la culture » (page 99).
À la fin des années 1920, Corneliu Zalea Codreanu instituteur d'origine polonaise (en fait il est né "Kornelius Zieliński") anime des sentiments antisémites et anticommunistes, il crée pour cela la Garde de fer qu’on pourrait qualifier de mouvement intégriste chrétien autoritaire. Rentré en Roumanie, Cioran provient professeur de philosophie durant l’année scolaire 1936-1937. Il développe des idées reprenant certaines thèses de la Garde de fer, mais a un regard critique sur les conséquences des promesses en matière de vie éternelle du christianisme (page 118). Dans son ouvrage sorti en 1937, Des larmes et des saints, on peut lire : « Les Hongrois nous haïssent de loin tandis que les Juifs nous haïssent au cœur même de notre société » et « Le Juif n’est pas notre semblable, notre prochain, et, quelle que soit l’intimité entretenue avec lui, un gouffre nous sépare ». Ces phrases ne sont pas citées par Anca Visdei, peut-être parce que ces passages seront désavoués ultérieurement par l’auteur et disparaîtront donc de nouvelles éditions.
Notre personnage arrive en France à l’automne 1937 comme boursier de l’Institut français de Bucarest. Toutefois Cioran retourne encore deux fois en Roumanie, un premier séjour se fait durant l'automne 1939, et un second entre novembre 1940 et fin février 1941. Dans les années d’avant-guerre, il fréquente les gens du PPF, qualifiant Doriot de « meilleur d'entre les nationalistes, avec des aptitudes de chef ». Information que nous apportons personnellement.
C’est à Paris que durant l’hiver 1941-1942, Cioran rencontre Benjamin Fondane, un juif d’origine roumaine, un homme de lettres qui sera déporté en 1944. Leur fréquentation fait évoluer Cioran du point de vue idéologique. Le 18 novembre 1942, il rencontre Simone Boué qui deviendra sa fidèle compagne et lui assurera un confort matériel modeste mais sûr. En mars 1944, l’Armée rouge franchit le Dniestr (qui marque la limite orientale de l’ancienne Bessarabie, revenue à la Roumanie en 1919), elle occupe progressivement la Roumanie. Un régime prosoviétique puis franchement communiste s’installe dans ce pays et Cioran se désintéresse d’autant plus à son pays de naissance que ses livres y sont alors interdits et que sa nationalité roumaine lui a été retirée. Il restera apatride durant presque durant tout le reste de sa vie. En 1970 il écrit : « Mon pays : ce n’est pas une patrie, c’est une plaie, une blessure qui n’arrive pas à cicatriser » (page 342).
La partie de l’ouvrage qui court de 1945 à la mort de Cioran couvre la moitié de l’espace, il est là qualifié d’hypocondriaque. Il entre de plein pied comme auteur de littérature française. Son œuvre connaît un succès grandissant et il déclare: « J’ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès ». On reconnaît là les caractéristiques de sa production faite d’aphorisme, ascétisme et humour, avec une pincée de pessimisme. Anca Visdei considère que les aphorismes de notre auteur sont « des lignes intenses, portées par une humeur exprimée avec une observation fine et et précision aigüe » (page 333). Ajoutons qu’Imre Kertés écrit que « Cioran est formidable, parfois éblouissant ; mais derrière ses propos, j’entends toujours les sanglots impuissants d’un enfant profondément blessé » (page 243). Si Cioran meurt en 1995 à Paris, Simone Boué décède noyée deux ans plus tard, son corps étant retrouvé sur une plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
On peut regretter que la dimension d’adhésion de Cioran aux idées de la Garde de fer ne soit pas plus développée. En effet Cioran fut largement accusé d’avoir été fasciste. À notre propre initiative, retrouvons à ce propos ce qu’écrit Traian Sandu dans son article "Mircea Eliade et Emil Cioran : fondamentalisme orthodoxe ou recentrage européen du fascisme périphérique roumain ?" dans Histoire de la littérature et jeux d’échange entre centres et périphéries, les identités relatives des littératures : « La nature idéologique de la Garde de fer s’avéra ainsi pleinement adaptée à la société roumaine et payante en termes de recrutement et de massification du mouvement fasciste roumain : tout en correspondant à l’idéologie fasciste euro-synchrone – moderniste, urbaine, industrialiste, dynamique et violente – qui attirait, à l’image de Cioran, les jeunes cadres urbains, dynamiques mais peu nombreux de la Roumanie traditionnelle, (Eliade) n’oubliait pas la phraséologie traditionaliste, ancrée de l’idéologie réactionnaire et raciste "Blut und Boden" qui pouvait attirer les cadres ruraux tels que les prêtres et les instituteurs de campagne, qui combinaient religiosité ancestrale et nationalisme plus moderne » ("Blut und Boden" = "Du sang et de la terre").
S’il considéra que son admiration pour les mouvements d’extrême-droite fut une erreur, Cioran nous semble que pour autant il préserva toute sa vie une certaine unité de pensée imprégnée de pessimisme et de ressentiment mais effectivement il se dégagea, d’ une vision nietzschéenne de l’homme rédempteur qui fait fi de croyances et de morale, pour être responsable de sa vie et de son bonheur. Tout ceci l’amena à approfondir une dimension de scepticisme et de nihilisme.
Pour connaisseurs Aucune illustration