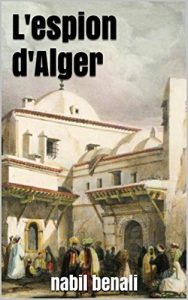[Cet article est une tribune libre écrite par Nabil Benali, auteur de « L’espion d’Alger », qui témoigne de l’absence d’un accord entre historiens sur un large pan de l’histoire algérienne.]
Je ne suis pas historien, mais auteur de fictions. Je ne prétends donc pas pouvoir proposer un point de vue académique ou argumenter en faveur d’une thèse scientifique, mais juste tenter de partager mon expérience dans l’écriture du roman historique.
Désirant raconter une histoire d’espionnage qui se passe dans l’Alger de la Régence turque et des corsaires barbaresques, j’ai naturellement consacré plusieurs mois à un intense travail documentaire, le genre exigeant une connaissance parfaite de l’époque — et même du quotidien de l’époque. Un écrivain de romans historiques doit, ce n’est qu’une image bien sûr, être capable sur le champ de se fondre parmi les gens de l’époque dont il parle si une machine à remonter le temps pouvait l’y emmener. Dans le cas de la Régence d’Alger, notamment la fin du XVe et le début du XVIe siècle, je me suis bien vite retrouvé au milieu d’un maquis de production historique qu’il n’était absolument pas évident de débroussailler. Et pour cause !

Avec son passé tumultueux et ses légendes passées au patrimoine universel, Alger a toujours séduit — et ne cesse de le faire— écrivains, peintures et poètes, photographes et musiciens. Delacroix, Dinet, Fromentin ou Vernet ont fondé l’école d’Alger en peinture. Les débuts de la photographie ont coïncidé avec l’occupation française de l’Algérie et les « nouveaux territoires » ont vu défiler les grands photographes qui dominaient les différentes expositions universelles… Mais comme Tunis ou Tripoli, quoi que chacune se distingue à sa façon, cette cité qui s’est imposée dès le XVIe siècle dans l’Histoire de la Méditerranée n’a pourtant pas fait l’objet d’une écriture historique qui, à défaut d’être définitive, puisse aujourd’hui cimenter un consensus entre les historiens et les spécialistes. Si tel était le cas, on disposerait enfin d’une Histoire d’Alger qui permette à ce magnifique théâtre de tant d’événements majeurs de disposer de son propre décor et de ses personnages bien définis, et même de ses accessoires ainsi reconstitués dans le moindre détail. Écrire des histoires en se disant qu’on a reconstitué l’époque d’alors avec beaucoup de réussite deviendrait tellement plus simple. Mais c’est loin d’être le cas.
Rareté des ressources documentaires et polémiques mémorielles
Plusieurs problèmes se posent s’agissant précisément de la ressource documentaire. Primo, sa rareté. La quasi-totalité des ouvrages décrivant Alger et sa vie politique, militaire et sociale d’alors ont été le fait de quelques auteurs occidentaux ; des chroniqueurs, des diplomates, des espions aussi — dont beaucoup étaient chargés de mesurer les murailles de la ville et de compter l’armée et son artillerie. Une partie du fonds documentaire sur lequel l’on peut s’appuyer également consiste en les correspondances entre le régent d’Alger et ses homologues européens, Français surtout. En face, presque aucun texte en arabe ou en turc ne nous est parvenu et à ce jour, la référence centrale pour parler d’Alger au tout début de la Régence turque demeure la « Topographie et Histoire générale d’Alger » et « l’Histoire des rois d’Alger », écrits par l’abbé bénédictin espagnol Diego de Haedo, lui-même détenu jadis à Alger. Pour certains, et cela est écrit de la sorte dans l’encyclopédie participative Wikipédia, ces deux livres sont l’unique référence sur Alger au début du XVIe siècle. En tout cas, aucune source n’est aussi détaillée s’agissant de la description de la ville et des us et coutumes de ses habitants. Fouad Soufi, chercheur au Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle d’Oran, constate (dans une contribution disponible sur le site du Crasc) que « l’accès à l’information historique reste encore très difficile » et que « l’inexistence d’un service d’information sur l’histoire de l’Algérie, la mauvaise circulation de l’information historique, des ouvrages et des rares revues, l’absence de revue historique régulière ne facilitent pas la tâche (…)»
Autre constat non moins important : les ouvrages les plus en vue, devenus par la suite le matériau d’une production documentaire largement diffusée, sont ceux écrits par les esclaves chrétiens de retour chez eux et témoignant des affres de leur détention dans les bagnes d’Alger. Le plus célèbre de ces témoignages, encore publié à ce jour, reste celui d’Emmanuel d’Aranda. Sans doute propulsés par la charge émotionnelle qu’ils dégagent ou à cause d’une actualité faite de kidnappings des ressortissants occidentaux par les groupes djihadistes (pour certains, c’est l’Histoire qui se répète), ces récits divisent néanmoins les historiens, suivant la rive de la Méditerranée sur laquelle ils se trouvent. Robert C Davis, dans « Esclaves chrétiens, maîtres musulmans » (éditions Jacqueline Chambo – 2006), représente aujourd’hui le travail le plus sérieux jamais fait sur la question (10 ans de recherches). Il a surtout la particularité de ne pas considérer que l’esclavage des chrétiens par les corsaires barbaresques fût basé sur un critère racial, mais il le replace, malgré son ampleur et ses affres, dans le contexte des conflits géopolitiques et économiques d’alors.
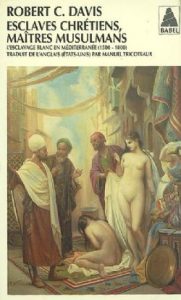
Robert C Davis n’est cependant pas une opinion majoritaire en Occident. Le fait que la piraterie en Méditerranée a cessé au jour de la prise d’Alger par l’armée française en 1830 reste, à ce jour, l’argument le plus fort chez beaucoup d’historiens occidentaux pour soutenir, dans une lecture plutôt manichéenne, que sans les razzias qui ont été derrière l’asservissement de plus de 1.00.000 de chrétiens 3 siècles durant, jamais il n’y aura eu d’expédition contre Alger, de même que le projet de pacification par l’occupation coloniale qui s’en était suivi.
Il arrive aussi que les lectures débordent du cadre euromaghrébin pour s’installer dans les polémiques mémorielles plus vastes. Une relecture de la course (ou de la piraterie) barbaresque est, par exemple, proposée par l’historien africaniste Bernard Lugan. Il considère, dans une réponse au dirigeant turc M. Erdogan lorsque ce dernier demandait à la France de s’excuser pour ses crimes coloniaux en Algérie, que la présence turque en Afrique du Nord a été « un génocide ». Il rappelle la longue liste des crimes des ottomans en Afrique du Nord, avant de donner son point de vue sur les razzias barbaresques : « Il s’agissait bien de piraterie et non de Course puisque les raïs, les capitaines, n’obéissaient pas aux règles strictes caractérisant cette dernière ». Et de dire que la recherche historique a « montré que son but n’était pas de s’attaquer, avec l’aval des autorités, à des navires ennemis en temps de guerre, mais que son seul objectif était le butin ».
Du côté algérien, on pense tout autre, bien entendu. On rappelle tout d’abord que c’était l’Église qui encourageait et utilisait les récits des captifs pour réunir davantage de dons et de soutiens à la rédemption de leurs coreligionnaires détenus à Alger. Des récits généralement écrits bien des années après leur retour à la maison et qui peuvent de facto manquer d’objectivité et de précision, voie d’honnêteté. On considère, de ce côté-là de la Mare Nostrum, que la question des esclaves chrétiens n’aura été, au vrai, que le prétexte du projet colonial, et on accuse même les homologues occidentaux de volontairement escamoter les courses menées par les chrétiens et qui faisaient à leur tour des détenus musulmans en Europe.
Dans ses recherches sur l’Algérie à l’époque ottomane, Lemnouar Merouche affirme, s’agissant de la course : « On sait que longtemps après sa disparition, elle a continué à imprégner les esprits des deux côtés de la Méditerranée, à travers le cliché sur «le nid de pirates» auquel répondait en écho le mythe de «l’âge d’or». Les belles pages de Braudel sur la course en Méditerranée ont rendu ce genre de procès complètement obsolète pour les historiens sauf à l’étudier en tant que composante des conflits de mémoire. »
Plus explicite, Benjamin Stora rappelle que « l’histoire de l’Algérie produite par les historiens au temps de l’apogée de la splendeur coloniale française visait à expliquer pourquoi ce pays devait rester de toute éternité dans le giron de la France. C’était là le facteur central de légitimation du récit historique. La présence française remontait ainsi à l’Empire romain. Une insistance était mise sur la latinité de l’Algérie, avec un rattachement mythologique ancestral entre ce territoire de l’Afrique du Nord et l’Europe du Sud ».
Difficultés pour la création littéraire
Pour ce qui m’occupe, soit l’écriture d’un roman historique, je pense qu’écrire sur un pan de l’Histoire qui recèle une grande charge mémorielle, polémique et politique est tout sauf une chose aisée lorsqu’on cherche à placer son récit au cœur du véritable contexte de l’époque, avec ses faits avérés et son vécu démontré par la preuve historique. La douloureuse mémoire du passé colonial de la France en Algérie et les divisions qu’elle entretient interfèrent à tous les niveaux de la production historique depuis deux siècles et jusqu’à ce jour. Pour un auteur, c’est un devoir de faire en sorte qu’elle n’aille pas non plus polluer l’imaginaire et ce monde libre qu’est la fiction, toute vraisemblable qu’elle se doit d’être.
La création littéraire n’a pas à s’embarrasser et encore moins à s’accommoder de ce que pensent les uns et les autres. Il est juste regrettable que le principe soit nettement plus facile à mettre en œuvre dans le roman moderne. Pas dans le roman historique où les murs et les témoins ne sont plus là, et où il ne reste pour reconstruire les premiers et convoquer les seconds que le précieux travail des historiens. Encore faut-il qu’eux aussi disent la même chose. S’entendront-ils un jour ? Je l’espère. Alger mérite bien cela. Elle qui fut la ville où Miguel de Cervantès a vécu, juste avant d’écrire Don Quichotte et inaugurer ainsi la merveilleuse aventure du roman…
Nabil Benali
Auteur de « L’espion d’Alger »
https://www.amazon.fr/Lespion-
![[tribune libre] Fiction et ressources documentaires : écrire malgré les spécialistes de l’Histoire ?](https://www.gregoiredetours.fr/blog/wp-content/uploads/2017/08/hotel-de-la-marine-825x510.jpg)