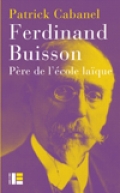Avis de Adam Craponne : "Elle marchait avec un léger déhanchement de pierreuse"
Notre titre est emprunté à une phrase de Marcel Aymé, Noël Arnaud explique que : « Les pierreuses étaient des prostituées du dernier rayon qui racolaient dans les terrains vagues ou les chantiers de construction ». Ce mot est très en vogue durant tout le XIXe siècle, époque où la capitale connaît de grand bouleversements urbanistiques et s’agrandit de la totalité d’anciens villages (comme Belleville) ou de parties de ceux-ci (comme le Pré-Saint-Gervais). D’ailleurs on trouve en particulier mais pas seulement des pierreuses dans la zone des fortifications.
La prostitution évolue considérablement durant ce siècle, tout d’abord elle migre quasi-totalement des îles et en partie du Quartier latin et du Palais-Royal aux grands boulevards (à ne pas confondre avec les boulevards des maréchaux). Le vocabulaire voit d’ailleurs apparaître pour désigner certaines prostituées les mots "boulevardière" et "asphalteuse" qui marque l’évolution du revêtement des rues. Comme le montre la carte pages 236-237, ce sont à la fois les maisons de tolérance et les rues de racolage qui ont partiellement migré. Les squares et bancs publics, récemment apparues, sont en partie appropriés par le racolage. L’ouvrage, qui se centre sur la période du Second Empire, ne le dit pas mais on peut penser que vers 1900 la zone autour de chacune des diverses gares est un lieu où l’on trouve aussi nombre de filles des rues.
D’autre part sociologiquement la prostitution ne se limite plus aux filles dont c’est l’unique occupation mercantile (qu’elles soient en maison ou dans la rue), elle a vu nombre de femmes employées dans les cafés ou restaurants parisiens s’y adonner ponctuellement et elle s’est élargie aux grisettes (qui sont le jour ouvrières ou employées), aux lorettes qui officient entre autre près de l’église Notre-Dame-de-Lorette (pas trop loin des limites extérieures du Paris d’avant 1860), aux comédiennes (spécificité parisienne, très nombreuses et souvent guère mieux payées que les ouvrières, mais qui ont en rapport de gros frais professionnels) et aux cocottes (prostituées de luxe pour en particulier de riches bourgeois).
Le contenu de cet ouvrage est précieux pour celui qui veut écrire ou est lecteur de romans historiques se déroulant au XIXe siècle, car il resitue tant le rapport de la société française à la prostitution, que des soupçons d’espionnage pèse (très souvent à tort) sur certaines demi-mondaines (comme la Païva), qu’ il rappelle des actrices qui deviendront célèbres comme Léontine Massin ont été quelques années des boulevardières (les mauvaises langues diront que son rôle de Nana dans une pièce adaptée du roman éponyme de Zola, n’était pas entièrement un rôle de composition), qu’il décrit un univers bien plus riche dans sa diversité qu’on ne pourrait le penser, et qu’il montre que pour les provinciaux et les étrangers Paris est un lieu de tourisme sexuel. Dans "La Vie Parisienne d’Offenbach" un baron suédois découvre Paris et l’œuvre se termine par un chœur où on avance que : «Du plaisir à perdre l’haleine ! Oui, voilà la vie parisienne.»
L’auteure a travaillé sur les archives de la Préfecture de police de Paris, des articles de journaux, des livres documentaires (soit éventuellement pour guider le petit béotien, soit parfois pour dénoncer l’univers en question) et des romans de l’époque. Les écrits et les représentations picturales sur les maisons closes ou les cocottes devinrent très nombreux en France pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Alexandre Parent-Duchâtelet (1790-1836),un médecin hygiéniste, a écrit le livre "De la Prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration" paru de manière posthume en 1836 (l'année de sa mort). Les frères Goncourt, Baudelaire, Eugène Sue, Théophile Gautier, les Dumas, père et fils, Tristan Corbière, Huysmans, Zola, Balzac, Flaubert, Maupassant, Barbey d’Aurevilly (et d'autres) ont évoqué ce monde de la galanterie parisienne. Ainsi en 1868, Zola l'auteur de "Nana", écrit-il :
« Je ne puis ouvrir un journal sans y trouver quelques nouvelles piquantes sur ces dames qui aident nos jeunes désœuvrés à devenir des hommes sérieux en les ruinant et en leur faisant perdre leurs cheveux.
La petite B. a gagné deux ou trois cents mille francs au jeu ; la grande G. a pendu hier la crémaillère dans son délicieux hôtel des Champs-Elysées, et dès onze heures, il y avait trois gentilshommes sous la table ; la blonde R. a giflé la brune P. qui lui volait sa clientèle. Tout cela est exquis.
Les journaux ont raison de nous tenir au courant des faits et gestes du beau monde. Quand l’abonné de la province peut se dire, le soir, en se couchant : "Ah ! Ah ! Il paraît que Turlurette a de nouveaux diamants", il s’endort du sommeil du juste et rêve que la France est heureuse ».
Lola Gonzalez-Quijano, en plus d’une introduction et d’une conclusion, propose dix chapitres d’une vingtaine de pages bien conçues afin de permettre de papillonner de l’un à l’autre, sans être obligé de lire cet ouvrage en suivant l’ordre des pages. Ainsi le chapitre sur les comédiennes s’intitule-t-il "scandale sur les planches" et on donne dans la table des matières le nom de ses trois parties. Dans le chapitre gloire et déclin des maisons tolérance, on donne les adresses des huit établissements de luxe parisiens ; d'avant la Première Guerre mondiale, le Chabanais le seul à être vraiment resté dans les mémoires (le One two two n’ouvrira qu’en 1924 et le Sphinx, avec comme maîtresse des lieux Marthe Le Mestre dite "Martoune", est créé un peu plus tard). Mais la maison la plus célèbre sous le Second Empire est celle de La Farcy (au 4 rue Joubert) que fréquente Toulouse-Lautrec (sa tenancière termine ses jours comme châtelaine du Chesnoy et bienfaitrice de la ville de Montargis) . Ce dernier passe également souvent au 6 rue des Moulins chez La Fleur blanche, un établissement célèbre pour sa chambre des tortures.
Parfois un petit saut dans le XXe siècle permet d’introduire une information significative, voire plaisante, ainsi page 47 :
« les agences de voyages de présenter dans les années 1930 ces maisons de luxe comme des curiosités propres à la capitale française. Des touristes n’hésitent pas alors à débourser 35 francs pour visiter le 6 rue des Moulins ou 50 francs pour le Chabanais, alors que pour monter avec une fille il ne faut s’acquitter que de 20 francs ».
Il semblerait qu’au milieu des années trente au Sphinx le tarif était de 30 francs, sans compter les pourboires et les cadeaux ; c’était donc la maison la plus chère. Notons que l’ouvrage "Capitale de l’amour : filles et lieux de plaisir à Paris au XIXe siècle" offre huit pages proposant une vingtaine d’illustrations avec en particulier un cliché de Cora Pearl qui fut maîtresse de deux membres (sic) de la famille impériale, des photographies de restaurants connus principalement pour offrir des cabinets particuliers et une photographie par Eugène Atget (à qui on doit des milliers de clichés sur la vie à Paris au tout début du XXe siècle) d’une prostituée des rues déguisée en jeune fille.
Pour connaisseurs Quelques illustrations
du 22 septembre 2015 au 20 janvier 2016
En savoir plus sur http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/88829-les-images-de-la-prostitution-en-france-1850-1910-au-musee-d-orsay#8HwkgICjmVFP61u2.99
En savoir plus sur http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/88829-les-images-de-la-prostitution-en-france-1850-1910-au-musee-d-orsay#8HwkgICjmVFP61u2.99